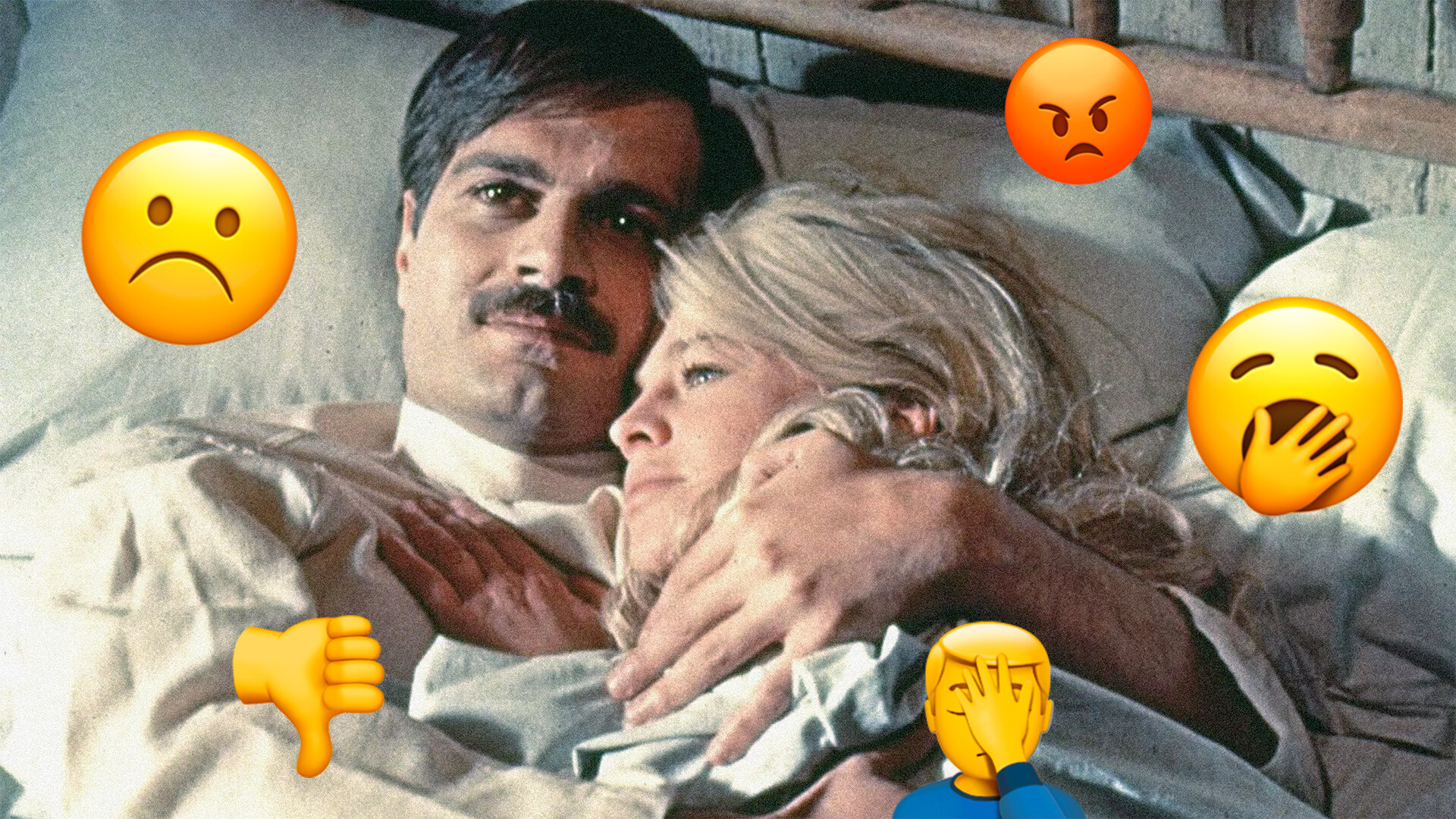
Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr
Alexandre Pouchkine. Les Récits de feu Ivan Pétrovitch Belkine

Pouchkine, qui est devenu célèbre en tant que poète, a écrit plusieurs œuvres en prose qui font désormais partie des grands classiques russes. La critique littéraire soviétique a fait l’éloge des Récits de feu Ivan Pétrovitch Belkine, des nouvelles réalistes prétendument créés par le narrateur, dont Pouchkine affirmait avoir retrouvé les notes. Mais les contemporains du poète étaient d’un tout autre avis.
Bien que les critiques aient souligné un style « fluide », ils ont déploré l’« absence d’idées » de l’œuvre. Certaines histoires étaient qualifiées d’anecdotes un peu trop longues. « Les Récits de feu Ivan Pétrovitch Belkine sont faciles à lire, car ils ne poussent pas à réfléchir », lisait-on dans un journal de Saint-Pétersbourg, Abeille du Nord. « Des farces enveloppées dans un corset de simplicité, sans aucune pitié », déplorait le magazine Moskovski Telegraf.
Le principal critique du XIXe siècle, Vissarion Belinski, a également noté que les Récits avaient été accueillis avec froideur par le public et les journalistes. Dans une série d’articles consacrés à Pouchkine, il a loué et admiré son talent, mais noté : « Bien qu’on ne puisse pas dire qu’il n’y eût rien de bon en elles, ces histoires n’étaient néanmoins dignes ni du talent ni du nom de Pouchkine […] L’une d’elles - La Demoiselle-Paysanne -est particulièrement pitoyable : invraisemblable, tirant sur le vaudeville, elle dépeint la vie d’un propriétaire terrien d’un point de vue idyllique... »
Selon certains chercheurs, toutes les nouvelles sont des parodies de blagues consacrées à la vie quotidienne, un genre en vogue à l’époque, avec un dénouement inattendu. Mais hélas, s’il s’agissait là d’humour, ses contemporains ne l’ont pas du tout compris.
Plus tard, dans les années 1860, les critiques ont jeté un nouveau regarde sur les Récits et, surtout, le narrateur Belkine, y voyant un chantre du caractère russe, doux et humble. Dostoïevski a écrit que tout ce qui est vraiment beau dans la littérature russe « est pris au peuple, à commencer par l’homme humble et simple qu’est Belkine ».

Gogol a lu sa comédie pour la première fois en 1836 dans la maison du poète Vassili Joukovski, où se réunissait tout le beau monde littéraire. Beaucoup ont ri, et Pouchkine (qui avait suggéré l’intrigue à l’auteur) « se roulait par terre de rire ». Toutefois, certains ont immédiatement condamné la pièce, y voyant une « farce offensante pour l’art ». D’autres ont qualifié la comédie de grossière et plate. D’autres encore ont tancé Gogol pour le côté invraisemblable de l’œuvre – selon eux, le dirigeant d’une ville ne pouvait pas confondre l’inspecteur venu de la capitale avec un simple aventurier arrivé par hasard. « Il n’était pas nécessaire de calomnier la Russie », a écrit le critique conservateur Faddeï Boulgarine, critiquant également Gogol pour l’absence de personnages positifs dans sa pièce.
Par un étonnant hasard, l’empereur Nicolas Ier en personne a autorisé la publication et la représentation au théâtre de cette comédie taclant les fonctionnaires provinciaux malhonnêtes : il n’a pas vu la métaphore de toute la Russie que contenait la pièce. Mais lors de la première, il a ri et dit : « Quelle pièce ! Tout le monde en a pris pour son grade, moi plus que quiconque ».
>>> Les dix plus grands auteurs russes de tous les temps
Le succès au théâtre fut retentissant, mais Gogol lui-même le considérait comme un échec ; il lui semblait que les acteurs ne comprenaient pas le sens de pièce et jouaient mal. Désespéré, il est même parti quelque temps à l’étranger pour se ressourcer.
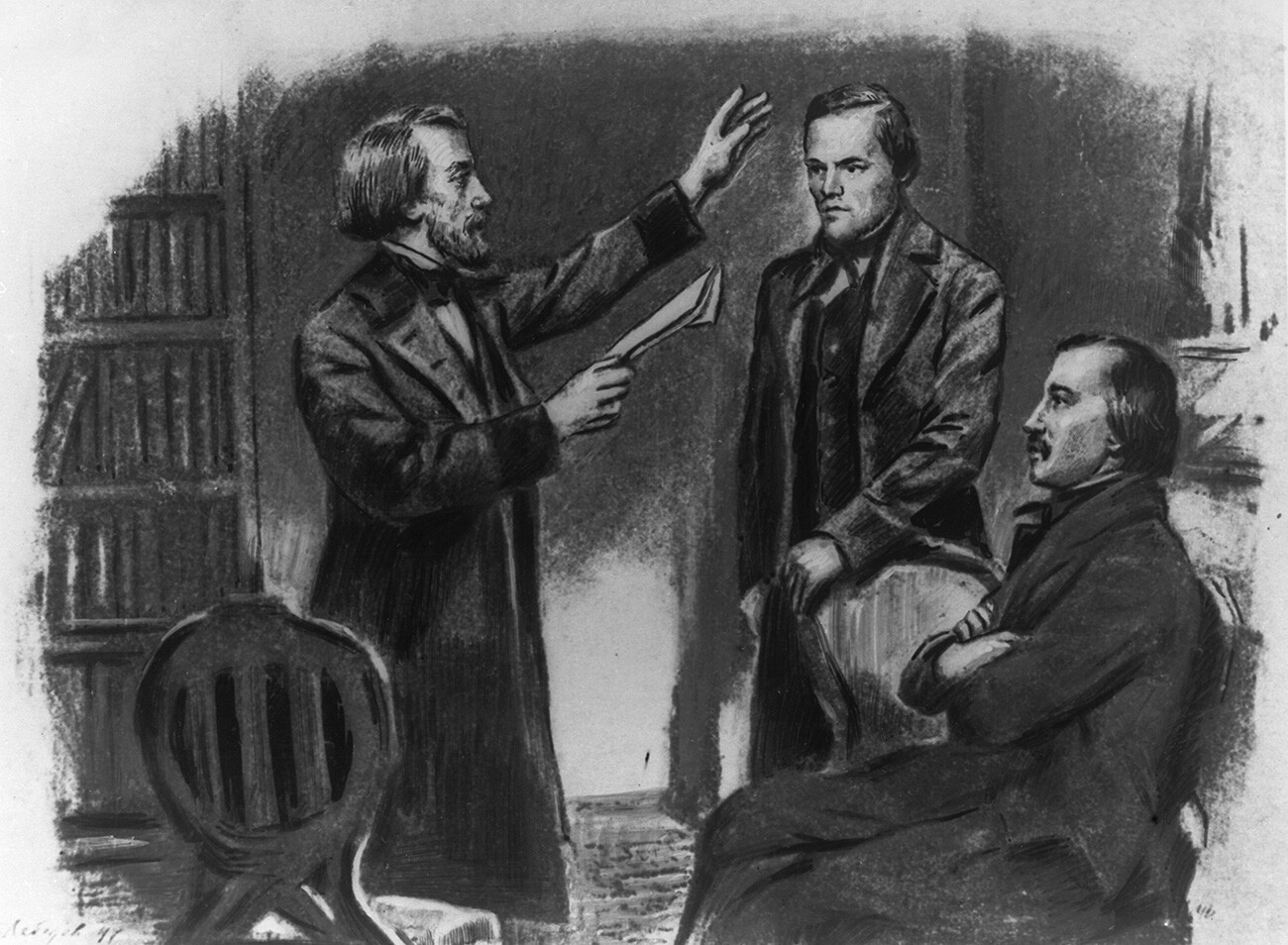
Roman consacré à un fonctionnaire de bas échelon au caractère mesquin, Les Pauvres Gens a été l’une des premières œuvres psychologiques de la littérature russe. Totalement emballé après avoir lu le manuscrit, le critique Belinski a qualifié son auteur « nouveau Gogol ». Avant même la publication de l’ouvrage, il a vanté dans tout Saint-Pétersbourg le nouvel écrivain de talent. Cela a eu un double impact sur la réception du roman. D’une part, ses éloges constituaient pour Dostoïevski un billet d’entrée dans le monde littéraire. D’un autre côté, de nombreux critiques se sont montrés méfiants, voire sceptiques, à l’égard de l’œuvre. L’un d’eux a même accusé Dostoïevski d’avoir été excessivement influencé par Belinski.
D’une certaine manière, c’était vrai : sous l’influence de Belinski, le jeune auteur a rejoint les membres du cercle de Petrachevski, caractérisé par leur état d’esprit révolutionnaire. Il leur a plus tard lu la lettre interdite de Belinski à Gogol, dans laquelle la Russie était critiquée - pour cela, Dostoïevski a failli être exécuté, voyant la potence remplacée in extremis par des travaux forcés.
Les Pauvres Gens a été critiqué pour son absence de forme et son contenu trop flou : « À partir de rien, il a décidé de construire un poème, un drame, mais rien n’en est sorti, malgré toutes les prétentions à créer quelque chose de profond », écrit le journal Abeille du Nord. Beaucoup ont critiqué la longueur de cette œuvre et des détails inutiles et fastidieux (Belinski lui-même a concédé plus tard que le roman était encore trop verbeux).
>>> Dix mémoires et journaux intimes russes on ne peut plus captivants
Le critique Apollon Grigoriev a qualifié la sentimentalité de l’auteur de « fausse », et ne croyait pas que Dostoïevski « vénérât » sincèrement des personnalités aussi modestes que son héros. Certains ont accusé Dostoïevski d’avoir imité Gogol et ses Nouvelles de Saint-Pétersbourg. À ce propos, Gogol a lu le roman et loué le talent de l’écrivain, tout en notant que l’auteur était encore jeune et qu’il y avait beaucoup de verbiage : « Tout aurait été beaucoup plus vivant et plus fort si cela avait été plus condensé ».

Aujourd’hui, ce roman sur la guerre civile, qui a valu à Pasternak le prix Nobel de littérature, est considéré comme l’une des plus grandes œuvres de la littérature russe du XXe siècle. Cependant, en URSS, il n’a été publié qu’après la perestroïka, et l’auteur a été soumis à de violentes persécutions.
Le comité de rédaction du magazine Nouveau monde, où les nouveautés étaient publiées, a déclaré dans une lettre ouverte que le livre dépeignait de manière calomnieuse la révolution d’Octobre ainsi que les gens qui « ont fait cette révolution et bâti socialisme en Union soviétique ». Le prix Nobel a été qualifié d’action politique. Selon Nouveau monde, le prix était le fruit d’un « battage médiatique antisoviétique autour du roman » et ne reflétait en aucune manière « les qualités littéraires de l’œuvre de Pasternak ».

Aux États-Unis, un pays alors très puritain, quatre maisons d’édition ont refusé de publier ce « roman érotique ».
Beaucoup craignaient des dommages pour leur réputation, voire des litiges. Dans le même temps, les refus polis adressés à l’écrivain étaient accompagnés de critiques très positives. Ce n’est qu’en France que quelqu’un a osé publier le roman, le directeur de la maison d’édition ayant admiré la façon dont l’auteur « a réussi à transférer la tradition littéraire russe dans la prose anglaise moderne ».
Le livre avait des chances de passer inaperçu, mais un scandale a éclaté à son sujet dans la presse britannique. Dans les pages du Times, Graham Greene a recommandé Lolita comme l’un des meilleurs livres de 1955, tandis que le rédacteur en chef du Sunday Express, John Gordon, a contredit son collègue, le qualifiant de « livre des plus sales » et de « pornographie évidente ».
Dans de nombreux pays, ce roman sur la relation entre un homme adulte et une mineure a longtemps été interdit. La diffusion d’un ouvrage dans lequel la pédophilie était décrite de manière si esthétique (et presque justifiée) était considérée comme nuisible, voire dangereuse. En France, le roman a également été interdit après sa parution, mais la maison d’édition a ensuite obtenu devant les tribunaux le droit de le publier à nouveau.
En URSS, le livre était bien entendu interdit. Nabokov lui-même a déclaré avec ironie qu’il lui était difficile d’imaginer quel type de régime et de censure pourrait permettre la publication d’un tel roman dans sa « patrie guindée ».
Cependant, il a été activement diffusé en samizdat (publication clandestine) et des allusions à Lolita sont apparues sous la plume des célèbres poètes Andreï Voznessenski et Evgueni Evtouchenko. Le roman n’a pas été publié pour cause de « perversion », mais aussi à cause de la personnalité de l’auteur lui-même. La presse soviétique reprochait à Nabokov « un texte plein de snobisme et destiné aux petits-bourgeois curieux ». En 1970, un article publié dans la Gazette littéraire qualifiait Lolita d’œuvre d’un émigré qui a trahi et vendu sa patrie. La rédaction du journal a reçu de nombreuses lettres pleines de colère de lecteurs de ce « roman de l’émigré blanc Nabokov », qui demandaient qu’un avis de recherche international soit émis contre lui.
En 1989, Lolita a été publié en URSS, où il a connu un grand succès.
Dans cette autre publication, découvrez les dix écrivains russes et soviétiques les plus souvent adaptés à l’écran.
Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.
Abonnez-vous
gratuitement à notre newsletter!
Recevez le meilleur de nos publications directement dans votre messagerie.