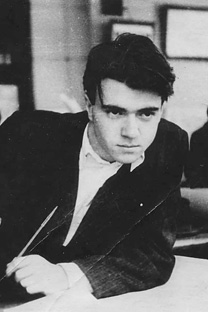« Un dieu est mort »

Crédit : Ricardo Marquina
Dalila Ovanessova, écolière en 1953
Dalila Ovanessova Source : archives personnelles |
Le jour de la mort de Staline, on nous a réunis à l'école, nous avons formé un rang solennel dans le couloir, on a mis de la musique funèbre. Je me souviens de la garde d'honneur des pionniers et des membres du Komsomol près du buste de Staline : ils se tenaient au garde-à-vous et saluaient. Tous pleuraient, les élèves et les enseignants. Je ne pleurais pas, j'étais perdue. Les cours ont été annulés pour le deuil et tout le monde est rentré chez soi.
Quand je suis rentrée chez moi, j'ai senti à la maison une joie sourde. J'étais peut-être soucieuse, mais je voyais ce plaisir, cette joie, l'éclat dans les yeux de ma mère, son activité, sa démarche légère, un état de libération mentale, de la joie. J'appelle « maman » ma grand-mère, elle m'a élevée avec mon frère. Mon oncle, le fils de ma mère, l'écrivain Youri Dombrovski, avait été victime des répressions. Il était alors en camp.
Mais elle ne nous disait rien. Qu'est-ce qu'on pouvait bien dire à cette époque à des enfants ? J'avais une amie à l'école, Valia Neskouchaïeva, sa maman et son papa lui avaient formellement interdit de me fréquenter. « Mon papa et ma maman ne m'autorisent pas à être amie avec toi parce que ta famille n'est pas fiable ». Ce mot m'avait surprise, je n'en comprenais pas le sens.
Alexandra Grigorieva, étudiante de l'Université de pédagogie en 1953
Alexandra Grigorieva Source : archives personnelles |
J'étudiais alors en quatrième année de l'Université de pédagogie à Baleï, dans la région de Transbaïkalie. Je me souviens aussi qu'en cours de pédagogie, nous devions apprendre à un grand nombre de citations de Staline. C'était très strict, à ce niveau-là. On a frappé tout à coup dans la salle de classe, la professeure est sortie, et quand elle est revenue, elle semblait décomposée. Elle s'est assise, a mis sa tête dans ses mains et a sangloté. Puis elle a levé les yeux et dit calmement : « Joseph Staline est mort ». Nous avons tous pleuré. Dans notre groupe, il y avait principalement des filles et seulement trois garçons, mais tous ont éclaté en sanglots.
Avec deux amies, on louait une chambre chez un vieil homme. C'était un vieux communiste, il avait travaillé toute sa vie dans la mine d'or. Quand nous sommes rentrées de l'école, il était assis sur un banc en face de sa maison et pleurait : « Eh bien, les Komsomols ? Comment on va vivre, qu'est-ce qu'on va faire ? Mon père est mort ». Nous ne savions vraiment pas comment vivre sans Staline.
Viktor Erkovitch, écolier en 1953
Viktor Erkovitch Source : archives personnelles |
En 1953, je vivais dans un village de travailleurs dans la région d'Irkoutsk. A l'école j'étais en huitième classe (14 ans, ndlr). Le village tout entier sanglotait littéralement. Les gens ne pleuraient pas, ils sanglotaient sans se retenir. Il semblait que la vie s'était arrêtée. Pour nous, qui étions alors au Komsomol, l'événement était encore plus tragique que la Grande Guerre patriotique.
Je me souviens que j'étais allongé sur mon pupitre dans la salle de classe, sachant que je devais pleurer, mais les larmes ne venaient pas. Et je n'étais pas inquiet du fait que quelqu'un me regarde et pense quelque chose. J'étais moi-même mal à l'aise de ne pas pleurer à un tel moment. Il me semblait que c'était anormal. Alors j'ai commencé à enduire de salive la partie située sous mes yeux pour simuler une manifestation de douleur.
}
Félix Kvacha, étudiant de l'Institut des Machines-outils en 1953
Félix Kvacha Source : archives personnelles |
En 1953, j'étais en deuxième année. Je vivais dans un appartement communautaire près de Moscou. Les chambres étaient grandes, il pouvait y avoir 20 personnes, un peu comme dans une caserne. Le soir, après les cours, la mort de Staline a été annoncée à la radio. Tous pleuraient, tout le monde était en état de choc, on aurait dit que c'était la fin du monde. Mais je ne pleurais pas, je ne m'arrachais pas les cheveux. Le lendemain, à l'Institut, au milieu de la journée, nous avons été emmenés faire nos adieux à la salle à colonnes de la Maison des syndicats. On formait une file immense, cinq cents personnes. On nous a donné l'ordre de ne pas se disperser, on nous a dit qu'on serait strictement contrôlés. Nous avons fait du sur-place pendant deux heures, puis on a commencé à avancer. Au début, on avançait assez aisément – lentement, avec des pauses, des appels avaient lieu régulièrement. Le soir, nous sommes entrés dans la rue Troubnaya, il y avait une foule immense, des milliers de personnes. Mais il ne restait presque plus personne de notre file. Peut-être que quelqu'un avait pris la tangente, et le reste avait été emporté par la foule. Peut-être qu'il restait cinq ou six visages familiers. Au-delà, c'était une masse solide, des visages étrangers et sévères. Le long du boulevard, il y avait des camions, et derrière eux des soldats. C'était le plus effrayant. La foule est restée là toute la nuit sans bouger. On faisait connaissance avec certains, ensuite quelqu'un disparaissait, certains essayaient de ramper sous le camion, les soldats les en délogeaient, certains se faisaient embarquer dans les véhicules, et je crois qu'après ils n'en ressortaient plus. Le pire, c'était d'être compressé contre un camion. Debout toute la nuit, sans boire et sans manger, sans possibilité d'aller aux toilettes. Toutes les cours étaient fermées, les entrées d'immeubles aussi. Et puis soudain, je me suis retrouvé à trois cents mètres de la place Troubnaya, des garçons sont arrivés, seize ou dix-sept ans. Nous formions un groupe compact, ils discutaient entre eux de la façon d'avancer, fallait-il passer par les toits ?
Ces garçons m'ont finalement sauvé : on a trouvé une porte d'immeuble mal fermée et ils m'ont fait venir. Nous sommes passés dans une cour, puis une autre, puis nous sommes montés sur le toit, et là je les ai perdus. Ensuite, j'ai sauté du toit et je me suis retrouvé dans une rue parallèle, sur le boulevard Tsevtnoï, épuisé, mais vivant.
Valentina Chichkina, écolière en 1953
Valentina Chichkina Source : archives personnelles |
Nous étions à la maison, nous avons entendu l'annonce de la mort de Staline à la radio, tous ont pleuré : ma mère, ma sœur aînée. Moi aussi, je pleurais. C'était la mort de l'homme le plus important, celui qu'on aime plus que son père et sa mère, un dieu. Le lendemain, nous sommes allés à l'école, il y avait une file de deuil, ici aussi tout le monde pleurait. Ma sœur aînée Tamara est allé à l'enterrement avec une amie. Ma mère ne voulait absolument pas la laisser y aller, elle s'interposait devant la porte de façon théâtrale. Mais elles y sont quand même allées. De la chaussée de Leningrad, alors une banlieue de Moscou, on allait à pied jusqu'au centre, jusqu'à la place Pouchkine, six ou sept kilomètres, parce que les tramways ne fonctionnaient pas. Sur la place Pouchkine la bousculade a commencé, ça poussait de derrière, elles ont eu peur. Elles ont rampé sous une voiture et sont arrivées à se faufiler jusqu'à une ruelle. Les soldats les ont laissées passer, les filles étaient terrifiées. Alors elles sont rentrées à la maison par la chaussée de Leningrad.
Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.
Abonnez-vous
gratuitement à notre newsletter!
Recevez le meilleur de nos publications directement dans votre messagerie.