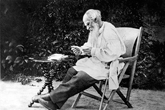Le retour d’une littérature d’idée en Russie
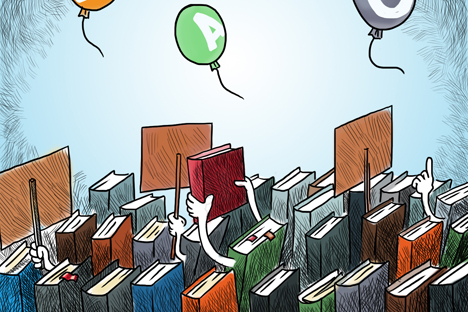
Dessin de Konstantin Maler
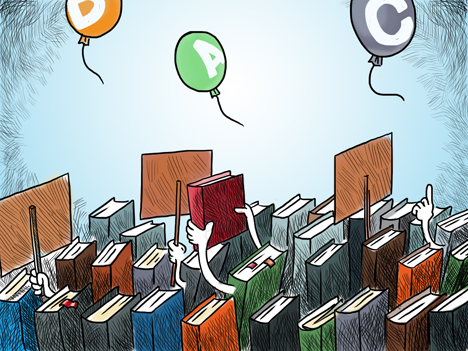 Dessin de Konstantin Maler
Dessin de Konstantin Maler
Dans les années 1990, à la chute de l’URSS, on pourrait penser que les écrivains sont enfin libérés de toute censure idéologique. Ne serait-ce que parce que personne ne s’en soucie vraiment. Le pétrole, la lutte pour le pouvoir, les chaînes de télé et les médias sont au centre de l’attention, pas la littérature.
Pour des raisons historiques, la littérature en Russie a longtemps assuré des fonctions multiples, remplaçant tantôt les traités de philosophie, tantôt la liberté de la presse ; s’attelant à la politique tout comme à la religion. Et voilà que chacun se mit à se limiter à son domaine de responsabilités. Aujourd’hui, la Russie connaît la liberté de la presse, la liberté politique, la liberté de conscience et de culte. Les églises officient au grand jour, les divers partis politiques s’expriment, tout comme au Parlement, et les journaux écrivent ce qu’ils veulent. Quant à l’écriture, son statut est à part, en dehors du gouvernement et de la société.
Mais 15 années ont passé depuis, et le gouvernement semble aujourd’hui se rappeler, non de son plein gré, de l’existence de la littérature. Trop souvent, et avec trop de conviction, la société russe s’est entendu dire que son niveau culturel baissait, que son système éducatif s’effondrait, que sa littérature traversait une crise, tout comme le monde de l’édition, les bibliothèques… Et que le marché ne résolvait rien. Qu’il fallait l’intervention de l’Etat.
A cela s’ajoute un autre facteur : la forte augmentation de l’activisme politique d’opposition depuis la fin des années 2000. Moscou et Saint-Pétersbourg ont vu défiler toutes sortes de manifestations auxquelles prenaient régulièrement part écrivains et hommes de lettres. Cela a joué son rôle. Le gouvernement a bien été obligé de tourner la tête et de voir que, oui, la littérature existe, et qu’elle a son propre avis sur la question.
C’est à ce moment-là qu’on a commencé à parler d’une régulation financière dans ce domaine. Accorder une aide à certains, que l’on refuse catégoriquement à d’autres. La question se pose bien évidemment : n’y a t-il pas un risque d’encadrement de la liberté d’écriture, de son droit à s’exprimer en toute indépendance ?
Maintenant, les écrivains se verraient à nouveau dicter ce qu’il doivent écrire et surtout ce qu’ils ne doivent pas écrire. Exactement comme sous l’Union soviétique. Mais l’URSS représentait une idéologie étatique dont la Russie contemporaine est exempt, excepté peut-être si l’on considère le rôle abstrait du patriotisme et le souhait de ne pas trop critiquer le pouvoir. Et si critique il y a, elle ne doit certainement pas s’adresser au chef de l’Etat ! L’Etat actuel cherche encore sa ligne idéologique qui permettrait à une communauté littéraire de se former et d’exiger : « voici ce que nous voulons ». Pour l’instant, rien à craindre de ce côté-là.
Paradoxalement, la littérature russe contemporaine elle-même manque d’idées politiques claires. Seule consolation, quelques oeuvres qui s’apparentent à ce que l’on pourrait nommer un roman politique. D’ordinaire, les écrivains politiquement engagés se livrent à ces activités parallèlement à leur vie littéraire : ceci est mon roman, et là est mon engagement politique.
Pas d’idéologie politique donc, mais une conception du monde en revanche bien présente. Ainsi s’est formée historiquement la littérature en Russie. Or une littérature à l’écart de la société, qui n’existe qu’en vertu de ses obligations de belles-lettres ici ne survit pas. L’esprit de Tolstoï et Dostoïevski est toujours présent. Pour le lecteur russe, tout ce qui apporte une réflexion philosophique, a trait à des questionnements existentiels, ne suscite pas vraiment d’intérêt. L’esthétique pure, plus communément désigné comme l’art pour l’art, ne touche qu’un public restreint, bien spécifique. Mais lorsque l’oeuvre aborde des questions sociétales, prend position dans le débat, elle éveille alors l’intérêt du lecteur, et ce, indépendamment de sa qualité artistique.
A cet égard, le roman retentissant de Zakhar PrilepineSan’kia est loin d’être un chef d’oeuvre, pour rester soft. Par contre, il traite bien des jeunes révolutionnaires. Les oeuvres d’Alexandre Terekhov sont longues, lentes et pâteuses certes, mais son dernier roman Allemands, sur la bureaucratie moscovite, est un thème d’actualité. Et si les interminables épopées de Maxime Kantor sont violemment anti-libérales, elle restent finalement très vides de sens. Les personnages, le sujet, sont d’un niveau scolaire. Mais Maxime Kantor est lu parce que ses romans sont considérés comme porteurs d’idées.
Ou prenons Boris Akounine. Très politisé, il est l’auteur de la célèbre série de polars historiques qui suit les aventures du jeune détective Eraste Fandorine. Tout se déroule au XIXème siècle, sous l’ancienne Russie tsariste. Bien qu’il s’agisse de romans policiers, ils énoncent clairement la façon dont doit se comporter un gentleman envers les institutions, ce qui lui est permis ou non. C’est justement ce qui fait des textes d’Akounine un événement.
D’un point de vue purement stylistique et littéraire, je ne pense pas que ses romans soient vraiment écrits d’une main de génie. Mais ce sont avant tout des textes idéologiques, donc ils sont lus et appréciés.
Andreï Vassilevski est critique littéraire, rédacteur en chef de la revue littéraire Novy Mir. Article préparé par Yan Shenkman.
Que lisez-vous maintenant ? Tweetez @rbth_fr #livre
Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.
Abonnez-vous
gratuitement à notre newsletter!
Recevez le meilleur de nos publications directement dans votre messagerie.