Sans choix et sans avenir
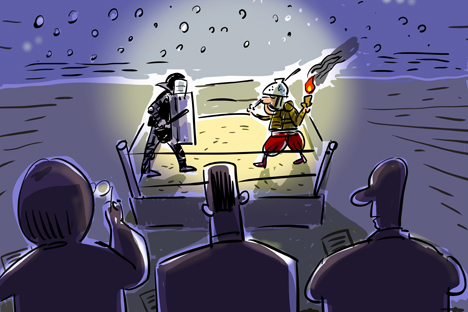
Dessin d'Alexeï Iorch
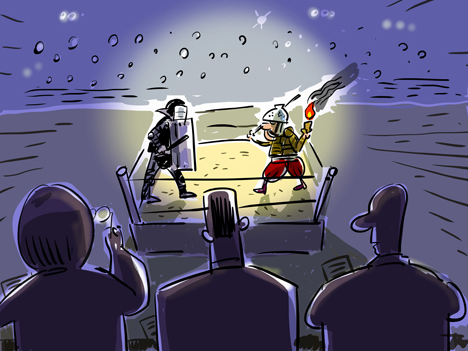 Dessin d'Alexeï Iorch
Dessin d'Alexeï Iorch
L’Ukraine a franchi les limites. La tension qui montait depuis l’automne dernier s’est terminée par un « 4 octobre » à Kiev. Il y a quelque 20 années, dans les rues de Moscou, le pouvoir et l’opposition réglaient leurs différends par la violence massive. Récemment encore, il semblait qu’une telle issue était impossible en Ukraine : la culture politique, les mœurs, la capacité de s’entendre ne sont pas les mêmes…
Mais le pire est ailleurs. En Russie, octobre 1993 fut une issue tragique de la lutte pour le pouvoir qui mit fin à toute discussion sur la direction que pouvait prendre le développement politique du pays. En Ukraine, il n’y a pas de fin, au contraire, la direction du développement, tout comme l’avenir de la structure étatique, est une question ouverte.
Depuis
l’apparition de l’Euromaidan, de nombreux parallèles ont été tracés
entre les cataclysmes actuels et la « révolution orange ». Mais le fond
de la situation n’est plus le même. Il y a dix ans, malgré les élections
présidentielles chaotiques et dramatiques et tout ce qui s’en est
suivi, il s’agissait du renouvellement politique, économique, étatique.
Il s’agissait de l’avenir. Aujourd’hui, l’avenir ne fait pas partie du
cours des événements.
Les parties de cette confrontation violente qui
a envahi Kiev, n’ont pas d’objectifs stratégiques depuis le début. Les
opposants du conglomérat au pouvoir cherchent à s’emparer du pouvoir
sans se demander, l’espace d’un instant, ce qu’ils vont en faire.
Attirer un patronat extérieur est l’objectif principal. Le soutien russe est essentiel pour Ianoukovitch, car la Russie est la seule source de colmatage des trous budgétaires et de survie économique. L’opposition compte sur l’Occident qui, idéalement, doit formuler sa tactique et sa stratégie, chose qu’elle ne peut pas faire seule.
L’Ukraine est victime d’une contradiction fatale. Ses problèmes sont d’ordre interne. En une vingtaine d’années d’indépendance, le pays n’a pas trouvé de réponse aux questions sur les objectifs et les formes du développement national. C’est une tache compliquée, compte tenu de l’hétérogénéité économique et mentale. L’échec de la construction des institutions étatiques viables s’est soldé par le fait que l’Ukraine est devenu un pays où la primauté revient non à l’état, mais à une société civile particulière. C’est un ensemble de communautés, de groupements d’intérêts et de pratiques relationnelles informelles et plus formalisées. Les thèmes abordés dans la politique ukrainienne en 2014 sont les mêmes qu’en 1992. Tel est le degré du progrès en plus de vingt ans.
La « révolution orange » a montré que l’Ouest a clairement suivi la spécificité de l’Ukraine, en se confortant simplement à ses propres orientations idéologiques et en mettant l’accent sur la société civile. Toutefois, un dialogue direct avec la société permet de catalyser les processus souhaités, mais ne garantit pas le résultat recherché, comme l’a démontré la « révolution orange ». Aussi, transformer ces processus en une réalité politique est une tâche qui revient à un état abouti. Les institutions étatiques en Ukraine n’en sont pas capables, car elles ne se sont jamais formées en tant que structures de prise de décisions.
La situation est très dangereuse. L’effondrement des institutions ukrainiennes présente un risque élevé de participation directe d’acteurs extérieurs. La volonté de l’Allemagne de montrer son goût retrouvé de leadership européen, l’instinct américain qui exige qu’on suive de près le renforcement potentiel de la Russie, la volonté de Moscou de prouver son droit de préemption au sein de l’espace post-soviétique…Tout cela risque de conduire à une spirale de conflit que personne ne souhaitait réellement. Compte tenu de la qualité du trophée potentiel et des coûts éventuels, la lutte pour l’Ukraine est tout sauf utile.
Le scénario idéal serait que la Russie et l’UE se mettent d’accord sur un protectorat informel qui garantirait la préservation des frontières actuelles de l’Ukraine et se chargerait de la responsabilité qui l’élite nationale déchue n’a pas pu assumer. Toutefois, un autre scénario est, malheureusement, plus probable : la Russie et l’Occident s’accuseront mutuellement de l’aggravation de la crise en Ukraine et entameront une bataille « par procuration », en soutenant les partis opposés et en exacerbant la division.
En 2008, quand, à l’initiative de l’administration de Georges Bush, s’est posée la question de l’octroi à l’Ukraine et à la Géorgie du Plan d'action pour l'adhésion à l’OTAN, la fuite de la conversation entre Vladimir Poutine et les membres du sommet Russie-OTAN a eu une grande résonance publique. Le président russe a souligné le caractère artificiel des frontières ukrainiennes et a appelé à calmer le jeu afin d’éviter de provoquer une confrontation interne. A l’époque, l’Occident a interprété cela comme une menace, alors que Poutine, en réalité, a fait un cours intensif pour son collègue américain. Pour Bush, la courte histoire de la création de l’Ukraine dans ses frontières actuelles a clairement été une révélation. La collision 2013/14 montre que personne à l’Ouest n’a réellement compris la situation ukrainienne.
Les réflexes géopolitiques couplés aux clichés idéologiques (« choix de l’Europe », etc.) conduisent à une crise majeure qui pourrait largement dépasser ses frontières.
Fedor Loukianov est président du Conseil pour la politique extérieure et la défense
Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.
Abonnez-vous
gratuitement à notre newsletter!
Recevez le meilleur de nos publications directement dans votre messagerie.


