La Fin de l’homme rouge ou le temps du désenchantement
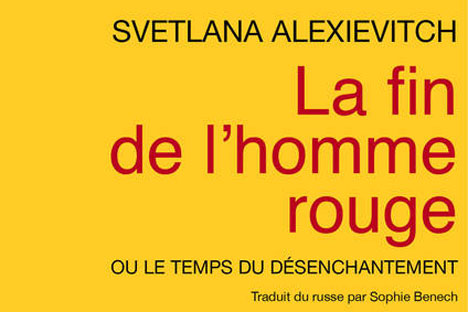
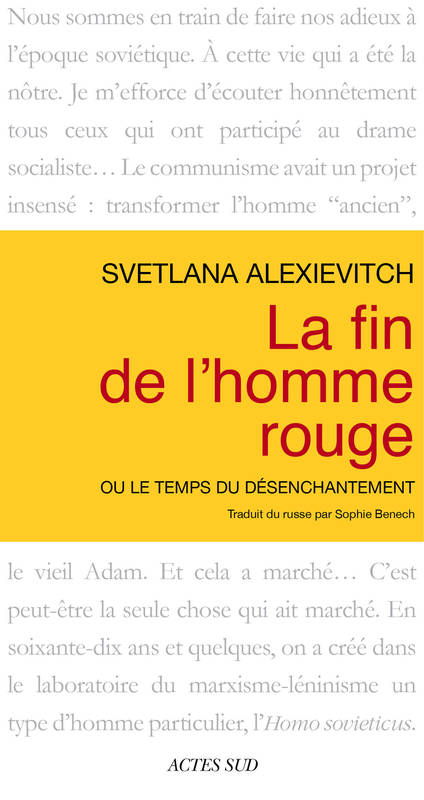 TITRE : La Fin de l’homme rouge ou le
temps du désenchantement
TITRE : La Fin de l’homme rouge ou le
temps du désenchantement
AUTEUR : Svetlana Alexievitch
ÉDITIONS Actes sud
TRADUIT par Sophie Benech
Avec La Fin de l’homme rouge Svetlana Alexievitch achève son travail d’archiviste inspirée qui n’est pas sans rappeler celui de Soljenitsyne.
Pendant une trentaine années, l’auteure régulièrement pressentie pour le Prix Nobel, a collecté les témoignages de cet « homme rouge », cet homo sovieticus, dont elle écrit : « Il me semble que je connais cet homme, je le connais même très bien, nous avons vécu côte à côte pendant de nombreuses années. Lui - C’est moi ».
Et sans doute fallait-il être l’un d’entre eux pour que s’ouvrent les vannes et que s’écoule, après tout ce temps de silence, avec autant de puissance, d’honnêteté et d’impudeur parfois, le flot de la parole.
Svetlana Alexievitch qui nous avait déjà donné les témoignages des combattantes de l’Armée rouge et de personnes nées pendant la Deuxième Guerre mondiale, des soldats d’Afghanistan ou des rescapés de Tchernobyl rassemble là un chœur que l’on aurait aimé discordant.
Mais curieusement, et quel que soit le point de vue du témoin anciens communistes ou anti-communiste, jeunes ou vieux, nous entendons le même refrain : « C’est toute une civilisation qui a été flanquée à la poubelle ».
« La vie en Russie doit être féroce et sordide, du coup l’âme s’élève … » dit l’une des personnes interviewées. Le peuple russe serait-il ainsi voué à la souffrance ? C’est ce que l’on pourrait croire tant ces destins qui s’accumulent s’apparentent souvent à des chemins de croix.
Vies en lambeaux d’êtres ballotés par l’absurdité de l’Histoire, laminés par la férocité humaine : « On peut survivre au camp, mais pas aux êtres humains » dit une femme dont la voisine au moment de sa déportation a adopté la fille et qui apprend plus tard que c’est cette même voisine qui l’avait dénoncée.
Il y a aussi pourtant dans ces récits sur l’époque soviétique un élan vital, une aventure collective « construire un grand pays » tragique, trompeuse, certes, mais parfois aussi joyeuse, inspirée.
Dans les à-coups de l’histoire, l’individu, lui, a du mal à se construire, à construire un itinéraire de vie, puis à créer une unité, à défaut de cohérence, entre ce qui a été et le présent : « Nous nous étions fait des idées sur tout : sur l’Occident, sur le capitalisme, sur le peuple russe. Nous vivions de mirages ».
Plus dure est la chute. La plupart de ces « hommes rouges » sont débarqués, incrédules, aux portes du grand supermarché et leurs enfants les accusent : « Nos parents ont vendu un grand pays pour des jeans, des Malboro et du chewing-gum ». Désenchantement ; espoirs trahis par le communisme ou par le capitalisme ?
L’auteur se garde de tout jugement et de toute conclusion. Les voix qu’elle donne à entendre ne sont pas celles de héros mais d’humains qui se retournent sur leur passé et tentent de comprendre.
C’est ce qui fait de La Fin de l’homme rouge, un livre poignant, bouleversant, essentiel qui donne des clés pour comprendre la Russie et, surtout, de la matière pour comprendre la complexité humaine.
Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.
Abonnez-vous
gratuitement à notre newsletter!
Recevez le meilleur de nos publications directement dans votre messagerie.