La Russie reste pragmatique sur la Syrie
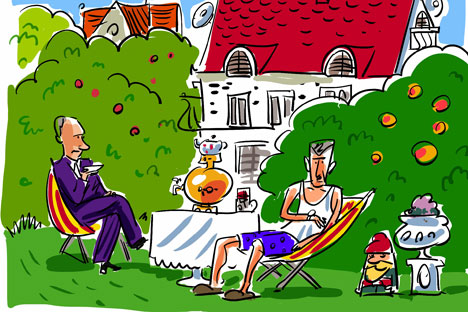
Illustration : Alexeï Iorch
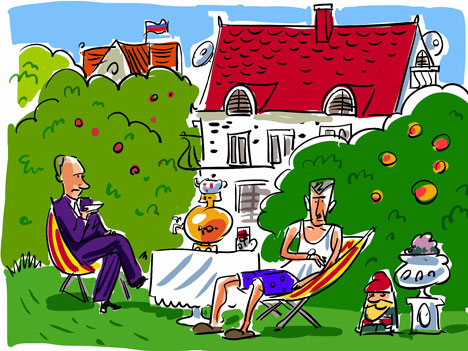 Illustration : Alexeï Iorch
Illustration : Alexeï Iorch
En décembre, lors de sa conférence de presse-marathon, Poutine a déclaré qu’après 40 ans de gouvernement par la famille Assad, « le besoin de changement était certainement à l’ordre du jour ». En effet, en 2011 déjà, le président d’alors, Dmitri Medvedev, avait prévenu qu’un « triste destin » attendait Assad s’il n’entreprenait pas des mesures pour réformer son gouvernement et pacifier son peuple.
Pour des raisons historiques, la Russie et la Syrie entretiennent de bonnes relations. Damas achète des armes russes tandis que les entreprises Stroitransgaz et Tatneft sont d’importants acteurs de l’industrie énergétique syrienne. Les échanges entre les deux pays ont augmenté de 58% en 2011, avant le début de la crise actuelle.
Mais ces relations sont aussi pragmatiques par essence. Et la position sur laquelle la Russie campe aujourd’hui l’est également, malgré la conviction, en Occident, qu’il s’agit d’une posture idéologique, d’un axe d’autocrates.
Moscou n’est pas tant guidée par son affection pour le régime en place que par la peur de ce qui pourrait suivre sa chute. L’expérience de l’Afghanistan, de l’Irak et de la Libye suggère qu’il est beaucoup plus facile de briser des états que de les ériger. L’Afghanistan est aujourd’hui une kleptocratie vacillante, qui finira déchirée entre talibans et seigneurs de guerre trafiquants d’opium, une fois que l’Occident se sera retiré. L’Irak dérive vers l’autoritarisme et le sectarisme. La Libye est un bazar que les djihadistes essayent d’exploiter.
Dans ce contexte, Moscou s’inquiète que la chute du régime syrien ouvrira une longue période d’anarchie dont les bénéficiaires seront l’islam fondamentaliste, l’Iran et la Turquie, les trois principaux adversaires de l’autorité russe sur ses marges au sud-ouest.
Le gouvernement russe continue de nier que les jours d’Assad sont comptés. Quand le vice-ministre des affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a suggéré que le président syrien risquait de se faire chasser, Moscou a rapidement fait marche arrière et réfuté ces propos. Mais dans la pratique, il semble que la véritable question qui s’impose de plus en plus est « quand » et « comment » le régime va changer, et non plus « si ».
La Russie espère une transition progressive et supervisée. Dans ses entretiens récents avec l’émissaire de l’ONU et de la Ligue Arabe, Lakhdar Brahimi, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a insisté : sans un « processus politique stable », la Syrie encourt le risque d’une « somalisation ».
Actuellement, n’importe quel accord de ce genre semble irréaliste. L’opposition syrienne n’est pas d’humeur à aller au compromis, ce que confirme le refus du chef de la Coalition de l’opposition syrienne, Ahmed Moaz al-Khatib, de venir négocier à Moscou.
Et nonobstant les pressions de Lavrov, Assad refuse lui aussi d’envisager des pourparlers significatifs. C’est inévitable, après tout, que son départ soit une condition préalable à toute véritable négociation.
Dans ce contexte, Moscou joue le peu de cartes qui lui restent en main.
La Russie envoie des forces navales dans la région, mais pas, comme certains le laissent entendre, dans le but de soutenir Assad ou défier l’Occident. Cette flottille est composée de trois navires militaires seulement : un croiseur qui date des années 1980, un contretorpilleur vintage des années 1960 et une frégate relativement moderne, mais de petite taille. Combattants de guerre ? Les deux premiers ont été conçus pour combattre d’autres navires et le troisième, des sous-marins. Les rebelles ne disposent ni des uns ni des autres.
Il y a aussi cinq navires de transport de troupes, presque vides, avec une petite armée d’infanterie navale. Cette flottille-là n’est pas destinée à la bataille, mais à l’évacuation des milliers de Russes en Syrie (et peut-être de la famille Assad), si besoin. Après tout, selon l’une des figures de l’opposition, Haitham al-Maleh, les Russes sont devenus une cible légitime.
La Russie se prépare néanmoins au pire, en reconstruisant des ponts brûlés avec la Turquie. Si la Syrie sombre dans le chaos et devient un autre berceau du djihad, la Russie aura au moins la maigre consolation de pouvoir dire au monde qu’elle avait prévenu l’Occident.
Mais le service final que la Russie pourrait rendre dans la résolution du conflit, c’est pousser Assad à quitter Damas. Lavrov a admis que le leader syrien a « répété en public et privé… qu’il ne comptait aller nulle part ». Mais même si la plupart des dictateurs sont enclins à une rhétorique sanguinaire et intransigeante, peu se battront jusqu’à la mort si on leur propose une échappatoire.
Si les réticences à diaboliser Assad signifie qu’en fin de compte Moscou pourrait l’inciter à partir pour permettre à un successeur d’atteindre un quelconque accord avec l’opposition, alors ce serait une contribution autrement plus importante que les tonnes de fusils d’assaut passés clandestinement aux rebelles. Peut-être qu’en ce moment-même une datcha douillette est préparée pour Assad dans la banlieue cossue de Moscou, Barvikha, non loin de celle des Milosevics de Serbie et des Akayevs du Kyrgyzstan…
Mark Galeotti est professeur de Relations internationales à l'Université de New York. Son blog : In Moscow’s Shadows.
Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.
Abonnez-vous
gratuitement à notre newsletter!
Recevez le meilleur de nos publications directement dans votre messagerie.